VIe S. avant J.C.
Présence humaine dans la zone.
Xe avant J.C.
Mumle apparait dans les documents d’archives sous différents noms : Mumlen, Mumelheim, Mumelsheim et actuellement Mommenheim. Les habitants sont surnommés d'hatze (les malhabiles, les mauvaises têtes), Fässelridder (chevaucheurs de tonnaux). Un village tributaire de la nature, les influences des inondations relèguent le ban aux activités de pâturages.
XIIe S.
L’abbaye bénédictine de Schwarzach, qui faisait alors partie du diocèse de Strasbourg, fait ériger l’église romane du village dédiée à Saint-Maurice. Le soubassement du clocher est le seul vestige datant de l’époque de cette fondation. Dès sa construction (la fin du XIIe ou le début du XlIIe s), le clocher a été prévu pour la défense au moins passive de la population. Il est possible que le cimetière ait été fortifié dès cette époque. La fortification du village apparaît comme étant nettement plus tardive.
XIIe S.
Blason : La forme simple de l'écu de notre village le situe avant le XIIIè siècle, certainement, en plein Moyen-Age, période de son rattachement à la ville de Haguenau. Les documents héraldiques d'Alsace, rapprochent son origine aux armoiries du patron de l'église locale Saint Maurice. Le choix d'un emblème sous l'impulsion de Louis XIV en 1696, s'oriente vers l'étendard de l'église locale. Saint Maurice, légionnaire romain du IIIè siècle, martyr, et mort en 290 à Agaunum ou Agaune, aujourd'hui Saint Maurice dans le Valais en Suisse. Sans réfuter cette hypothèse, une étude approfondie incite à divers commentaires justifiés : Maurice, décurion (Chef d'une décurie, division de la centurie, se forme de dix soldats) aurait été massacré pour avoir refusé de persécuter les chrétiens.
A cette époque l'étendard n'était pas de mode, son emblème ne lui revenant que bien des siècles plus tard. Vers 520, le roi des Burgondes, Sigmond, construisit un monastère à Agaune et donna le nom de Saint Maurice à cette ville du Valais suisse. Maurice était le patron de l'empire romain de nation Germanique, donc des empereurs successeurs de Charlemagne. C'est à l'autel de Saint Maurice, à l'antique basilique de Saint Pierre de Rome, que le nouvel Empereur fut couronné et reçut l'épée de son pouvoir et de sa dignité. Outre Mommenheim, vingt six localités vénèrent Saint Maurice en Alsace. De ces communes, seule celle de Mommenheim se réfère aux couleurs attribuées à ce Saint.
1300
1342 - 1354
Mumenheim entre d'office sous le contrôle de la Décapole (Zehnstâdtebund) officiellement le 28 août 1354. Le village est un «Reichsdorf» (village d'empire) relevant de la «Reichslandvogtei» (préfecture impériale) de Haguenau. Les paysans de la localité ne sont donc pas des serfs mais forment une communauté libre, ne reconnaissant que l'empereur comme souverain.
1349 - 1388
Les israélites de Strasbourg sont massacrés puis chassés. Ils vont se réfugier dans les campagnes. Ils n’ont pas le droit de posséder des terres donc ils exercent l'activité de Prêteurs sur gages. Mommenheim bénéficie de l'apport de cette communauté ; le commerce et la culture émancipent ce petit village. Le peuple juif trace une grande page d'histoire de notre village.
1600
1600 - 1650
Sous l'autorité de la ville de Haguenau, la population demeure catholique.
1618 - 1648
La guerre de Trente Ans (1618-1648) modifie la composition de la population. Notre commune, si elle n'est point bourgeoise, ressent plus d'affinités naturelles pour les grandes agglomérations urbaines. La ville haguenovienne épargnée par l'occupation suédoise protège son emprise territoriale. Les soldats haguenoviens sèment la terreur dans les villages sortant de leur dominance contractuelle L'éclatement du Saint Empire Romain au moment de la Réforme vers 1608 ainsi que le rattachement de l'Alsace à la France en 1648, modifient la composante démographique. Trente ans de guerre, dont le principal théâtre d'opérations allait être le pays Rhénan et particulièrement l'Alsace. Les affilées en présence étaient, avant tout, des mercenaires qui pour se rétribuer, pratiquaient l'enlèvement des récoltes et des bestiaux, pendaient, violaient.
Beaucoup de villages étaient détruits totalement ou en partie et certains ne furent jamais reconstruits. La population a diminué de 70 % du fait de la guerre proprement dite mais aussi du fait des épidémies et de la famine. De nombreuses terres agricoles ne furent plus cultivées pendant des décennies. Le traité de Westphalie en 1648 donna à la France les droits de la maison d'Autriche sur l'Alsace, ce qui devait lui permettre, en quelques années de reconstruction, de faire de notre région une province française. Le vide de population créa une immigration spontanée qui, par la suite, fut encouragée et organisée afin de franciser la population alsacienne. Diverses mesures furent prises afin de rendre française l’Alsace.
1698
Création du moulin sur la Zorn
1700
Le village reste de taille modeste et la plupart des maisons anciennes datent du XVIIIe siècle, les habitations antérieures ayant été détruites le plus souvent par fait de guerre.
Il faut savoir que le nombre des Israélites s'était considérablement accru au cours du 18ème siècle. Ce n'est que par lettre patente de 1784 que les Israélites d'Alsace obtinrent droit de cité. Ainsi se trouvaient, du moins partiellement, supprimées, à la veille de la Révolution, les discriminations remontant au Moyen Age. Cette lettre patente de 1784 ouvrait après des siècles de mépris et de persécution la voie à un statut égalitaire. A la fin du 18ème siècle, 75% des Israélites vivent en Basse-Alsace à proximité des villes. Ce qui explique, en partie, le nombre relativement élevé d'Israélites à Mommenheim en 1865.
1723
Mommenheim est composé d’une forêt de 128 arpents. La géologie du ban (fort en loess) permet une exploitation rentable et variée du sol.
1733
Un incendie accidentel ravage une grande partie du village : 60 bâtiments sont la proie des flammes, dont 24 granges de foin de regain et d’herbes.
1743
Construction d’un canal avec deux barrages. Il permet le fonctionnement constant du moulin ainsi qu’une bonne production d’énergie électrique.
1759
Reconstruction de l’église.
1760
93 habitants, 77 sont de religion catholique et 16 appartiennent au culte israélite.
1790
Ce sera Napoléon Bonaparte qui apportera les mesures d’amnistie permettant le retour de ces émigrés. Parmi eux citons, entre autre, le meunier Antoine Schifferstein (1755-1836) qui devient maire du village entre 1810 et décembre 1831. Cette famille devient dès lors l’une des plus importantes de la commune durant près d'un demi-siècle.
1793
La France révolutionnaire, en guerre depuis avril 1792, fait décapiter Louis XVI, le 21 janvier 1793, provoquant la formation d'une vaste coalition autour de la Prusse et de l'Autriche. Le pays est alors en crise et assiégé de toutes parts. La Convention réagit en février aux menaces d'invasion par la levée de 300 000 volontaires et l'instauration de mesures de salut public. Dans les villages les réquisitions se multiplient pour subvenir aux besoins des armées du Rhin et de la Moselle. Des tribunaux révolutionnaires d'exception entrent bientôt en activité pour combattre les complots réels ou imaginaires des ennemis de la République, et, le 30 mars 1793, la guillotine connaît ses trois premières victimes sur la place d'armes de Strasbourg. Un ensemble de mesures prises par le gouvernement de Salut Public avait fait naître une hostilité croissante de la population locale à l'égard de la Révolution : la constitution civile du clergé et la nationalisation de ses biens, la vente des biens communaux et nationaux à partir d’avril 1793, la métamorphose des églises en temple de la raison sont autant de raisons qui poussent près de 4000 paysans du secteur à se révolter et à prendre les armes contre la Révolution.
Ces derniers sont battus par la garnison française de Strasbourg à proximité de Mommenheim. Les forces coalisées décident alors de se replier sur la Moder. Réorganisées pendant ce répit, les armées du Rhin et de la Moselle désormais placées sous le commandement unique de Hoche lancent une contre-offensive à la mi-novembre qui aboutit en décembre ; après les batailles de Woerth et de Wissembourg les forces ennemies sont repoussées jusqu’à Landau. Commence alors une véritable chasse aux contre-révolutionnaires, les administrateurs du Bas-Rhin adressent aux districts le 27 novembre 1793. Ainsi, si les combats cessent dans la région, une partie de la population est contrainte de vivre en exil.
L'année 1793 connut aussi la destruction du moulin.
1800
La régularisation du Rhin lors des créations de son lit permet une évolution de la vallée de la Zorn. Le hameau de Mommenheim progresse avec la révolution industrielle et devient une plaque tournante de la vie économique de la vallée.
1800
Reconstruction du moulin
1833
Tracé prioritaire Paris- Strasbourg avec embranchement vers Metz. Le tracé quitte la vallée de la Zorn après Brumath et rejoint Strasbourg par le Nord.
1835
Première tuilerie de Mommenheim rentabilisée grâce aux 12 m d’argile exploités.
1836
Premier recensement, le village est composé de 9 rues :
Mühlgass Rue du Moulin
Untergrass Rue du Général Leclerc Kirchgass Une partie de la rue de l’Église actuelle
Kleinmumle Rue de la liberté
Judengass Rue des juifs
Landstrass Rue du Général de Gaulle Gaessel Klamm Rue des Romains Dordgraben Rue de la République
1843
On ne parlait pas en monnaie de singe mais en monnaie de bœuf, vache, cheval et même en monnaie d'homme ! En effet, pour refaire les chemins vicinaux (ceux qui relient les villages entre eux), il était opportun que les travaux soient effectués en nature. Le conseil municipal décida en 1843 pour la bonne exécution des travaux que les prestations suivantes étaient nécessaires : 3 journées de travail pour chaque homme du village, 3 journées de travail pour chaque bœuf, 3 journées de travail pour chaque cheval, 3 journées de travail pour chaque vache, 3 journées de travail pour chaque voiture à 2 et à 4 roues.
Tout cela était converti en francs et il fallait bien sûr connaître le nombre d'hommes et d'animaux dans le village.
Le calcul de conversion :
264 hommes qui valent 1 Franc chacun et qui effectueront 3 journées = 792,00 F
148 chevaux qui valent 2 Francs chacun et qui effectueront 3 journées = 888,00 F
27 bœufs qui valent 1 Franc chacun et qui effectueront 3 journées = 81,00 F
66 vaches qui valent 0,75 Franc chacune et qui effectueront 3 journées = 148,50 F
160 charrettes qui valent 0,50 Franc chacune et qui effectueront 3 journées = 240,00 F
Total = 2 149,50 F.
Même les vaches étaient assignées aux travaux d'intérêt collectif ! Les hommes, quant à eux, devaient faire preuve d'humilité puisqu'ils ne valaient que la moitié d'un cheval et guère plus qu'un bœuf...
1844
Gratuité de l'école pour les élèves indigents. En 1844, le conseil municipal s'est réuni pour décider de la fixation du taux de la rétribution mensuelle à payer par les élèves des écoles communales et du nombre des élèves qui peuvent y être admis gratuitement pour cause d'indigence. Rappelons quelques lois : Loi Guizot 1833 : l'école n'est ni gratuite, ni obligatoire
Loi Falloux 1850 : obligation d'avoir une école de filles par 800 habitants
Loi Ferry 1881 : gratuité pour l'enseignement élémentaire.
La commune de Mommenheim était avant-gardiste puisqu'elle possédait déjà une école de filles et pratiquait la gratuité pour les plus pauvres.
Toutefois, une augmentation du nombre de filles fréquentant l'école communale a provoqué une délibération du conseil municipal. En effet, cette augmentation exige l'entretien de deux sœurs institutrices au lieu d'une précédemment en poste alors que les revenus communaux n'ont pas progressé ! De ce fait, il a été décidé que, pendant l'année 1844, les élèves de ladite école de filles devaient payer 8 Francs par an et que le nombre des élèves à admettre gratuitement pour cause d'indigence était limité à quarante.
1850
La Gare de Mommenheim doit son implantation au refus de Schwindratzheim (qui ne sera qu'une halte).
1851
Transport : Inauguration ligne Strasbourg - Sarrebourg
Population : 1411 habitants dont 1085 catholiques, 2 protestants et 324 israélites.
1853
Construction de l’Orgue de l’église Saint Maurice par Joseph Stiehr
1856
Sens de l’implantation déplacé de 60° par rapport à la première construction. La tour est conservée dans son état d’origine. En complément de ces informations, vous pouvez vous rendre sur ce site qui recense tous les orgues de la région, dont celui de Mommenheim.
Population : 1272 habitants grâce à l’implantation du chemin de fer.
1871
L'Alsace et la Lorraine sont rattachées à l’Allemagne.
1895
Inauguration de la ligne n° 09 du chemin de fer. Elle débute à Mommenheim (Km Zéro) et se termine à Hargarten Falck au KM 124. Cette liaison entre Mommenheim et Sarreguemines fut et restera un point stratégique en toute circonstance : désordre sur d’autres lignes, évitement de Strasbourg en temps de guerre.
1898
Naissance du Corps des Sapeurs Pompiers de Mommenheim.
1900
1914
Début de la première guerre mondiale. 29 juillet 14 : les premiers réservistes reçoivent l’ordre de rejoindre immédiatement leur régiment. Les 1er et 3 août : l’Empereur d’Allemagne déclare la guerre, respectivement à la Russie et à la France. L’état de guerre est alors proclamé en Alsace : cette mesure place la région en état de siège et donne le pouvoir civil aux autorités militaires qui suspendent les libertés individuelles, les droits d'association et de réunion… L'Alsace-Lorraine devient ainsi une zone d'exception dans le Reich. La censure des correspondances est établie et l'approche des gares, des voies ferrées, des ponts est interdite. Un détachement de la « Bahnwache », la garde militaire des chemins de fer, prend possession de la gare de Mommenheim et en surveille les installations par des rondes armées.
En définitive, cette politique et les sanctions qui l'accompagnent, finissent par étouffer en partie la loyauté que la population locale pouvait avoir à l’égard de l’Empire allemand. En raison de la multiplication des cas de désertions, la plupart des Alsaciens-Lorrains mobilisés sous l’uniforme allemand sont envoyés sur le front russe. Dans le même temps, les premières opérations militaires commencent et placent l'Alsace-Lorraine au cœur des combats. Dès le début du mois d’août, Mommenheim est traversé par des wagons de troupes allemandes envoyés vers la frontière.
1915
Février : des hôpitaux de campagne sont installés, les jeunes filles rejoignent les rangs de la croix rouge et distribuent des denrées à la gare lors des passages des trains. Manque de main d’œuvre dans les champs : une pénurie s’installe. Mise en place d’un système de carte pour assurer le strict nécessaire même si souvent les produits sont manquants.
1917
Les cloches du village sont fondues pour fabriquer des armes et des munitions.
1918
Entrée des troupes françaises en Alsace. Juillet 1918 : Échec de la grande offensive allemande sur le front ouest, une victoire se dessine.
Délitement de l’empire allemand 11 novembre 1918 : L’armistice est signé.
21 novembre 1918 : Les premiers soldats français rentrent au village. À la tête de son état-major, le général Rampont reçoit les hommages du maire, Nicolas Steinmetz, et de la population massée à l’entrée de la commune sur la route de Saverne.
Ce retour des troupes françaises dans Mommenheim est marqué par le décès d’un ancien combattant français de 1870, Aloïs Woelffel, qui « meurt d’émotion » en retrouvant son ancienne patrie. À l’inverse, 24 jeunes gens originaires du village ont trouvé la mort dans la force de l’âge sur les différents champs de bataille d’Europe durant ces cinq années de conflit. 22 novembre 1918 : les troupes françaises sont à Strasbourg.
1918 - 1977
Activité de la tuilerie, rue de la Tuilerie (route vers Guebolsheim) exploite le gisement d'argile au lieu-dit Huettendoerfer Berg.
1919
L'Alsace et la Moselle redeviennent françaises.
Première élection des mairies par le peuple (depuis 1846 pour le reste de l’hexagone).
1939
Début de la Seconde Guerre mondiale
1939 - 1944
Occupation Allemande
1949
Ouverture de la première session du Conseil de l'Europe.
1997
Création de la Communauté des communes de Brumath, dont Mommenheim est membre.
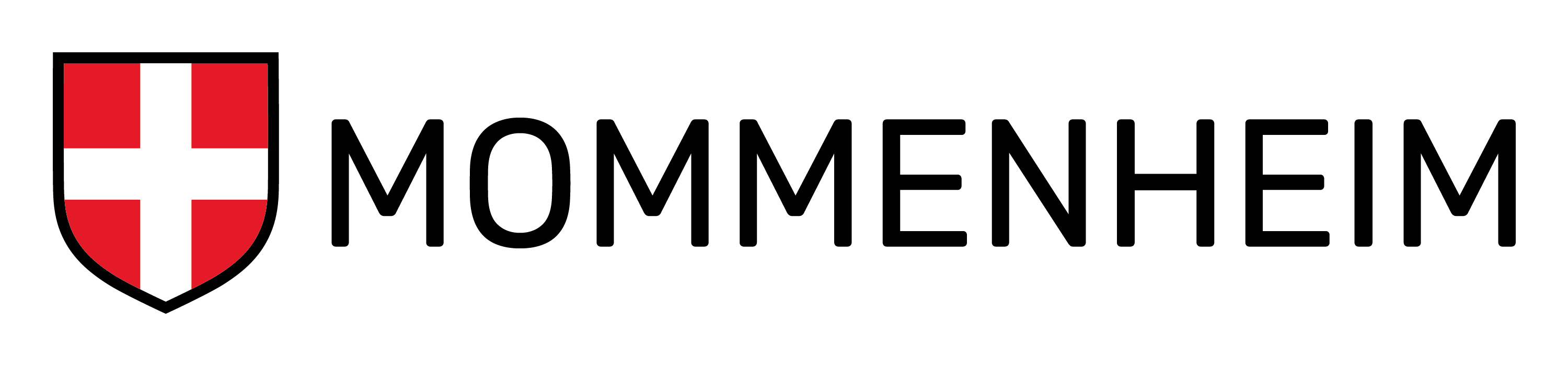
 Site créé en partenariat avec Réseau des Communes
Site créé en partenariat avec Réseau des Communes